| |
|
|
|
|
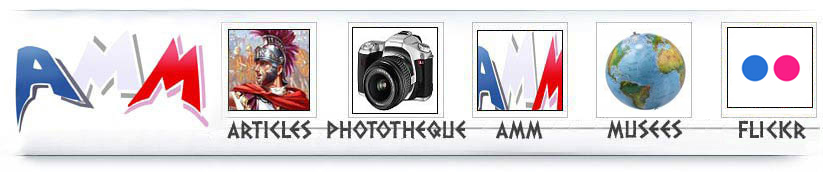
|
|
|
| |
|
|
|
|
 1689 Pavillon du Corps Royal Artillerie des Colonies Fréjus Musée TdM
1689 Pavillon du Corps Royal Artillerie des Colonies Fréjus Musée TdM


1689 Pavillon des ports de guerre Colonies Fréjus Musée TdM
English Translation
 |
Historique Voir ICI
History Click HERE
 |
Tout d abords il faut savoir ce qu'est un Pavillon . C'est une étoffe flottante au gré du vent,qui attachée à un mat sert à faire identifer par la forme, et ou la couleur le vaisseau et sa nation.Mais au début chaque nation et navire ne se sont pas bornés à un seul pavillon. il y avait plethore de bannieres pur distinguer les vaisseaux de guerre les vaisseaux marchands,et aussi signaler le rang des officiers qui se trouve à bors
A cela va s'ajoutere les pavillons de certaines villes commerçantes qui vont arborer le leur
IL a fallu légiferer et faut attendre Richelieu
Avant Richelieu et la réunion des beaucoup de provinces à la couronne de France les amiraux avaient libre choix d'arborer toutes les bannières,qu'ils voulaient sur les navires de leur juridiction,
Avant d 'embarquer il falait aller voir le l amiral qui donnait ses directives . avant Richelieu il n y avait pas de marine de guerre . Celle ci se composait de navires privés appartenant aux provinces Grands Armateurs ou commerçants qui combattaient sous la bannière du Roi
Les ports importants comme Marseille maitresse en mer Méditerranée, ordonnaient que tout navire tenu par un memebre de la ville ne devait poetaer qu'un pavillon de la ville pour Marseille celui du Comté et de la commune de Marseille,
Les vaisseaux de guerre
Lorsque le cardinal de Richelieu devint grand maître, chef et sur-intendant général de la navigation et du commerce, les pavillons des particuliers vont disparaitre .Ce processus avait deja vu un debut de reglementation avec l’Édit du mois de mars 1584, de Henry III mais il faut attendre en 1643, soit un an apres la mort du cardinal pour voir écrit noir suer blanc« La France porte d’argent, ou blanc, sans aucun blazon, pour l’ordinaire ». Cela sera confirmé par lL’ordonnance du 9 octobre 1661 affirmait que « le pavillon de la nation française » était le pavillon blanc.
Pendant un siècle et demi, jusqu’en 1790, le pavillon blanc uni, qui est le pavillon de la marine du roi, qu’il ne faut pas confondre avec le pavillon royal, sera l emblème des vaisseaux de guerre,saiuf pour les galères qui sera une branches distincte des vaisseaux, jusqu'à la suppression de ce coprs en 1748.Comme pour lacavalerie les galères avaient un étendard, et les vaisseaux le pavillon. Cet étendart est rouge, semé de fleur de lys d’or, chargé des armes de France, entourées des colliers des ordres de Saint-Michel et du Saint-Esprit.
Mais quid des navires de commerce
Quand l’unique pavillon des bâtiments de guerre fut devenu le pavillon blanc, les bâtiments marchands l’arborèrent, et le duc de Vendôme, alors grand-maître chef et surintendant de la navigation et commerce de France, publie le 6/10/1661 une ordonnance qui stipule que les navires marchands ne peeuvent arborer le pavillon blanc qui est réservé aux seuls vaisseaux de sa majeste Cette consigne sera répétée le 12 juillet 1670 quii stipule: « Les vaisseaux marchands porteront l’enseigne de poupe de couleur bleue, avec une croix blanche, transversante, et les armes de Sa Majesté sur le tout, suivant l’ancien usage. »
Pour compliquer les choses la grande ordonnance de Colbert, de 1689,allait semer la confusion
Il est écrit que les marques et enseignes des vaisseaux marchands », seront pour l’enseigne de poupe bleue avec une croix blanche traversante, ou telle autre distinction qu’ils jugeront à propos, pourvu que leur enseigne de poupe ne soit point entièrement blanche car le pavillon blanc,était l' apanage des vaisseaux du roi,
Cela sera répété la une autre ordonnance du 12 juillet 1670 : « Les vaisseaux marchands porteront l’enseigne de poupe de couleur bleue, avec une croix blanche, transversante, et les armes de Sa Majesté sur le tout, suivant l’ancien usage. »
Mais la confusion et l’obstination des marchands à porter, quand ils étaient éloignés des navires de guerre, le pavillon blanc, amenèrent le duc de Penthièvre, amiral de France, à donner aux vaisseaux marchands le pavillon des vaisseaux du roi. L’ordonnance du 25 mars 1765 (une année avant que parussent les Commentaires de Valin) édicte (Livre III, titre XIX, article 236) : « Permet Sa Majesté aux commandants des vaisseaux marchands de porter à poupe de leurs bâtiments une enseigne blanche, et d’y joindre telle marque de reconnaissance qu’ils jugeront à propos. »Depuis cette ordonnance de 1765, les navires de commerce français n’ont pas cessé de porter le même pavillon que les navires de la marine militaire : le pavillon national.
Les Corssaires
Les corsaire devaient arborer le pavillon de leur port d attache en plus d pavillon du roi. Par ordonnance spéciale de 1696, les corsaires pourront aborer t le pavillon blanc, jusqu’alors exclusivement réservé aux bateaux de guerre royaux. Cette disposition étaient considérée comme un insigne privilège pour la ville. Aucun navire ne pouvait porter à son mât le plus haut un autre pavillon que la pavillon royal, celui des corsaires de la ville s’y trouvait régulièrement.
Mais que designe t on par corsaire pirate flibustier?
Le mot pirate derive du latin “pirata” c'est à dire celui qui tente la fortune.C 'est un hors-la-loi qui pille les navires sans distinction et pour son propre compte.L n 'obéit qu'à ses propres codes et n' a aucun aucun code d’honneur
Ils travaillent pour eux même mais il faut savoir que les actes de piraterie sont sévèrement punis car un pirate arrêté est pendu sans aucune forme de procès. La société le considèer comme un bandit et il ne jouit donc d’aucun droit à la différence du corsaire.Le
Le corsaire
Son nom dérive aussi du latin “cursus” veut dire “cours”. C 'est donc un commandant de bateau qui, en temps de guerre, fait camapgn,e muni d'une commission du gouvernement.Ils peuvent en toute légalité lorsqu'ils sont mandatés d'aborder tous navires ennemis.
Le corsaire à la différence du pirate attaque des navires marchands appartenant aux ennemis de la couronne et ne s’en prend qu’au butin .Pour ces missions les corsaires sont protégés par un ordre de course (lettre de course). Ils sont soumis à des règles et ne pillent que sur demande. Aussi en cas de capture les corsaires, grâce à leurs lettres de course, ne sont pas pendus car ils sont considérés comme des prisonniers de guerre en attente de jugement et ont les mêmes droits.
parmi ces corsaires on peut citer le plus fameux Jean Bart mais aussi François l’Olonnais,qui a recu le surnom de “Fléau des Espagnols”car il attaquait tout particulièrement aux navires Portugais et Espagnols.
Mais les corsaires ne sont pas des membres de la Marine royale et iles ne peuvent attaqueer qu'en temps de guerre que s'ils ont la lettre de marque de leur gouverneur.
Les prises de guerre navires et partie du butin sert à payer la couronne. Le reste est pour le capitaine corsaire et ses hommes. Une fois la guerre terminée, le corsaire n’est plus sous mandat et donc plus lié à la couronne. Cependant, pendant les combats ils sont considérés au même titre que les matelots de la Marine royale.
Mais en temps de paix il se retrouve au chômage et,parfois devient d'excellent pirate car il est excellent marin entraîné et expérimenté et de plus iul connait les routes du trafic
reste le flibustier qui est un un pirate de la mer des Antilles qui a sevit notamment au XVII et XVIIIe siècle et uniquement dans la mer des Caraïbes. Les flibustiers ont un mode opératoire proche de celui des pirates car ils donnent l’assaut pour eux-même, mais peuvent être ponctuellement appelés à passer contrat avec les gouvernements lorsque ceux-ci manquent d’équipage.
Avant de passer au port de Bordeaux faisons une petite digression sur le Drapeau dit des pirates
Ce drapeau initialement appelé « Joli Rouge » par les boucaniers français de la mer des Caraïbes, deviendra au grès de déformation franço anglaisesle le Jolly Roger .
C'est un pavillon, orné d’une tête de mort et de fémurs croisés sur fond noir et va apparaitre au début du 18ième siècle.
C 'est I attribut le plus connu des pirates qui le hissaient pour inviter le navire poursuivi à se rendre sans combattre. Si ce dernier refusait, les pirates hissaient C 'est unalors le drapeau rouge pour indiquer qu’ils attaquaient, le combat serait alors sans merci.
L uitlisation de srapeau est interdit depuis 1929 par les traités internationaux
Toutefois il fut repris durant la première guerre mondiale par les sous-marins anglais regagnant leur base pour indiquer la réussite de la mission. Et cela continua durant la 2e guerre mondial
Les divers dessins qui figurent dessus on une signification précise
Les barres de couleur rouge représentent les bâtiments de guerre coulés
Les Barres Blanches indiqueny les nombres de Navires de commerc coules
Une dague une mission de debarquement Commanos
2 canons entrecroisés un navire coulé au canon
Pour les Pavillons de Guerre des ports Francais c'etaient des drapeaux distinctifs utilisés par la marine royale pour identifier les navires de guerre selon leur port d’attache. Ils variaient avant l’uniformisation progressive de la flotte sous l’Ancien Régime.
Voici un aperçu :
Jusqu'au règne de Louis XIV les es navires français n’avaient pas de pavillon national unique : chaque port militaire (appelé arsenal ou port de guerre) possédait son propre drapeau.
Les ports principaix étaient Brest, Toulon, Rochefort, Le Havre , et dans ces ports cs pavillons coexistaient avec le pavillon blanc à fleurs de lys, qui représentait directement le roi de France Pavillon qui devint de plus en plus dominant.
Voici quelques exemples des Pavillons par grands ports (XVIIe – début XVIIIe)
Brest (Bretagne) : pavillon à croix blanche avec canton jaune et aussi avec des hermines qui est un symbole breton.
Toulon (Méditerranée) : pavillon à croix blanche avec canton bleu semé de fleurs de lys.
Le Havre (Normandie) : pavillon à croix blanche avec canton rouge.
Rochefort (Atlantique) : pavillon à croix blanche avec canton orné de fleurs de lys dorées.
Bordeaux Atlantique Pavillon à croix Blanche avec canton orange orné de fleurs de lys dorées.
St Malo Bretagne Pavillon a croix blanche avecanton Bleu orné de fleurs de lys dorées.
Corps royal artillerie des Colonies Pavillon a croix blanche avec canton Vert Orange orné de fleurs de lys dorées
L’Ordonnance du Roi portant création du Corps royal de l’Artillerie date du 24 octobre 1784.
Les conditions dans lesquelles cette décision a été prise sont expliquées dans l’article précédent .
reprise du texte rédigé par le sous-lieutenant Lesueur, officier de réserve, affecté au 8ème régiment d’artillerie en décembre 1995.
Les articles 6 et 7 de l’ordonnance définissent la composition interne de chaque compagnie. Elles seront commandées "en tous temps" par un capitaine en premier, un capitaine en deuxième, un lieutenant en premier, un lieutenant en deuxième, un lieutenant en troisième ; ce dernier ainsi que la moitié des lieutenants en deuxième seront choisis parmi les sergents. Au niveau des sous-officiers et des hommes du rang, le détail de la composition est également précis. Ainsi est-il dit que les compagnies seront composées "d’un sergent-major, un sergent-fourrier-écrivain, 5 sergents, 5 caporaux, 5 appointés, 5 artificiers, 5 canonniers-bombardiers de première classe, 20 de seconde classe, 40 apprentis et un tambour formant 88 hommes".
La tenue La tenue est tout à fait caractéristique des troupes destinées à servir aux colonies et dépendant du secrétariat d’État à la Marine. L’uniforme des officiers et des soldats du Corps Royal de l’Artillerie des Colonies est un habit, avec une veste et une culotte couleur bleu roi. La doublure et les parements sont rouges, en écarlate pour les officiers et de drap garance pour les soldats. Les canonniers-bombardiers portent deux épaulettes rouges à franges de même couleur. Les artificiers portent les mêmes épaulettes dont la tige est liserée de jaune. Toutes ces épaulettes sont en laine et les grades des officiers sont distingués par des épaulettes en or. Les officiers sont sous les armes en hausse-col, en bottes, avec le baudrier en écharpe et l’épée à la main ; ils ne portent pas de giberne ni de fusil.
En outre, "les boutons seront jaunes et timbrés d’une ancre et du numéro 64. (...) Le retroussis de l’habit sera garni sur les devants d’une fleur de lys et sur le derrière d’une ancre". Les couleurs bleu et rouge sont caractéristiques de l’artillerie. La mention des ancres de marine prouve de manière éclatante, s’il en était besoin, la vocation à servir outre mer de ce régiment. Il n’est pas excessif de dire qu’il est l’ancêtre de tous les régiments d’artillerie des colonies. L’ancre en effet est un rappel des longs trajets que doivent effectuer sur la mer les troupes destinées à servir aux colonies comme les liens privilégiés qu’ils doivent entretenir avec la marine royale.
Organisation :
Il est composé de 5 brigades qui comportent 4 compagnies chacune. Aux 20 compagnies de canonniers-bombardiers viennent s’adjoindre 2 compagnies d’ouvriers. Le colonel, le lieutenant-colonel-directeur, un ou deux chefs de brigade, ainsi que le quartier-maître trésorier restent en France. Tandis qu’un lieutenant-colonel commande à Saint-Domingue (Haïti), un autre à la Martinique, et un dernier à l(Isle de France (île Maurice) ou en Inde. Le lieutenant-colonel destiné à l’Isle de France est provisoirement affecté à Pondichéry jusqu’à nouvel ordre. Le Régiment a trois brigades détachées après des trois commandants d’artillerie désignés plus haut. Les deux autres brigades sont à Lorient comme brigades de dépôt et de remplacement. Il est formé des détachements fournis par chacun des sept régiments de l’artillerie de terre. L’ensemble s’élève à 542 hommes. Il est complété par l’incorporation dans les 3 brigades détachées, des compagnies qui existent depuis longtemps dans les colonies. C’est à dire, 3 à la Martinique, 3 à Saint-Domingue et 4 à Pondichéry, fortes ensemble d’un millier d’hommes qui sont pour une petite partie les rescapés de renforts envoyés depuis la Métropole, mais surtout, des indigènes directement recrutés sur place : l’ensemble provient des 11 compagnies de bombardiers-canonniers de marine supprimés par l’ordonnance précitée.
Mentions particulières
Enfin dans les statuts du corps, il est prévu deux mentions particulières qui visent à éviter que le régiment ne perde toute mobilité en restant trop longtemps dans les mêmes lieux de garnison. Ainsi il est de "l’intention de sa Majesté que les troupes de l’artillerie des colonies changent de garnison autant qu’il sera possible tous les quatre ans". Un autre article précise plus loin "qu’aucun des dits officiers ne pourra contracter de mariage aux colonies avant l’âge de 25 ans révolus sans en avoir obtenu la permission du Roi". Il paraît évident qu’il s’agit pour le monarque d’interdire à ses troupes envoyées aux colonies qu’elles ne fassent souches sur place et que de manière plus générale, qu’une trop longue fréquentation des mêmes lieux et des mêmes personnes ne les fassent se sentir plus solidaires des intérêts des populations locales que de ceux du souverain. Il est à remarquer d’ailleurs que le régiment à sa création, comme nous l’avons vu précédemment, hérite à cet égard d’une situation déjà fort compromise.
Les faits
Le procès verbal de formation est dressé à Douai le 1er avril 1785 et est signé conjointement par Monsieur de Mazelaigne, commission des guerres, Monsieur le Maréchal de camp de Fredy, commandant en chef de l’artillerie de la place de Douai, Monsieur de Gay, lieutenant-colonel au nouveau Régiment et Monsieur de Macors, son Major. Le colonel du Puget d’Orval qui commande l’artillerie à la Martinique est chargé de diriger le Régiment. Et conformément à l’ordonnance du 24 octobre 1784, il est constitué en 5 brigades à 4 compagnies.
-
La 1ère brigade est stationnée en Inde. Elle comprend les compagnies suivantes : 1ère, 11ème, 6ème et 16ème compagnies.
-
La 2ème brigade est en France avec les 2ème, 12ème, 7èem et 17ème compagnies.
-
La 3ème brigade est à la Martinique avec les 3ème, 13ème, 8ème et 18ème compagnies. Trois compagnies y sont déjà, la dernière est attendue de France.
-
La 4ème brigade est en France avec les 4ème, 14èem, 9ème et 19ème compagnies.
-
La 5ème brigade, avec les 5ème, 15ème, 10ème et 20ème compagnies à Saint-Domingue (Haïti).
La revue d’effectifs qui est passée le même jour fait ressortir pour les compagnies présentes à Douai, un effectif de 20 hommes pour chacune d’entre elles.
Les années 1785 et 1786 se passent à compléter la composition du Corps. Le 15 octobre 1786 le Corps Royal de l’artillerie des Colonies quitte la garnison de Douai qui l’a vu naître et se dirige vers Lorient. Le 20 décembre 1786, certaines compagnies embarquent vers les Antilles et les autres colonies. Très vite, la compagnie envoyée à Saint-Domingue est durement affectée par les maladies tropicales.
Rien ne se passe dans les années précédant la Révolution si ce n’est qu’en prévision d’une reprise de la lutte avec l’Angleterre, que chacun sent imminente, les compagnies restées à Lorient essaiment dans un certain nombre de ports de la côte Atlantique, en particulier Port-Louis, Brest et Saint-Malo.
De fait dès 1790, la brigade de Saint-Domingue est confrontée à la révolte généralisée des esclaves noirs des plantations. En plus des maladies, elle perd un certain nombre d’hommes sous les coups des révoltés.
En plus des pavillons de guerre des grands ports métropolitains (Brest, Toulon, Rochefort, Le Havre), il existait aussi des pavillons pour distinguer certains ports coloniaux de la Marine royale, notamment aux Antilles et en Amérique du Nord.
Avant l’uniformisation par le pavillon blanc royal, chaque grand port militaire avait son pavillon spécifique.Dans les colonies, la Marine a également utilisé des pavillons locaux, inspirés de ceux de métropole mais adaptés.Les colonies principales à cette époque sont: Saint-Domingue (Haïti), Martinique, Guadeloupe, Louisiane, Guyane.
Pavillon colonial de guerre
On retrouve plusieurs attestations (XVIIe – début XVIIIe) :
Fond blanc avec croix blanche, comme en métropole (signe français en mer).
Dans le canton supérieur gauche, les armoiries ou symboles liés à la colonie (souvent dérivés des armoiries royales avec fleurs de lys).
Dans certains cas, les pavillons coloniaux reprenaient simplement le pavillon du port d’attache en France (exemple : Rochefort pour les Antilles).
Concrètement, le plus répandu semble avoir été :
Croix blanche sur champ bleu ou or, canton supérieur gauche orné de fleurs de lys (héritage de Rochefort et Toulon).
En Louisiane et aux Antilles, on utilisait surtout le pavillon blanc semé de fleurs de lys (version simplifiée royale).
Donc : le pavillon de guerre colonial était surtout une variante du pavillon de Rochefort (croix blanche sur champ or avec fleurs de lys), utilisé largement pour les flottes basées aux Antilles et en Amérique.
 |
Toutefois sous le regne de Louis XIV on assiste à l' instauration progressive du grand pavillon blanc (champ entièrement blanc, parfois semé de fleurs de lys), représentant le roi et les pavillons de ports tombèrent en désuétude, même si certains furent encore utilisés localement au début du XVIIIe siècle.
À partir de 1700-1715, le pavillon blanc devint le pavillon de guerre unique de la marine française
Voir Aussi See Also
1689 Pavillon des ports de guerre Brest Fréjus Musée TdM
1689 Pavillon des ports de guerre Bordeaux Fréjus Musée TdM
1689 Pavillon des ports de guerre Colonies Fréjus Musée TdM
1689 Pavillon des ports de guerre St Malo Fréjus Musée TdM
|
|
|
Copyright © 2003-2026 MaquetLand.com [Le Monde de la Maquette] et AMM- Tous droits réservés - Contactez l'Administrateur en cliquant ici
Ce site sans aucun but lucratif n’a pour but que de vous faire aimer l’ Histoire
Droit d’auteur
La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol
Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc)
Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande.
Principaux Collaborateurs:
Gimeno Claude (+)
Brams Jean Marie
Janier Charles
Vincent Burgat
Jean Pierre Heymes
|
Marie Christophe (+)
Jouhaud Remi
Gris Patrice
Luc Druyer
|
Lopez Hubert
Giugliemi Daniele
|
Nb
de visiteurs:8935848
Nb
de visiteurs aujourd'hui:2121
Nb
de connectés:65
|
|
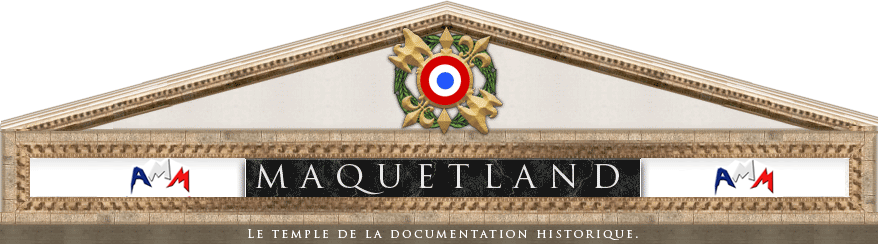
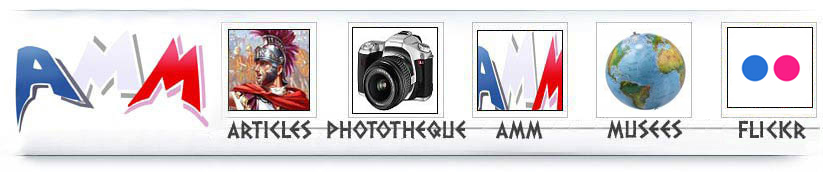




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

