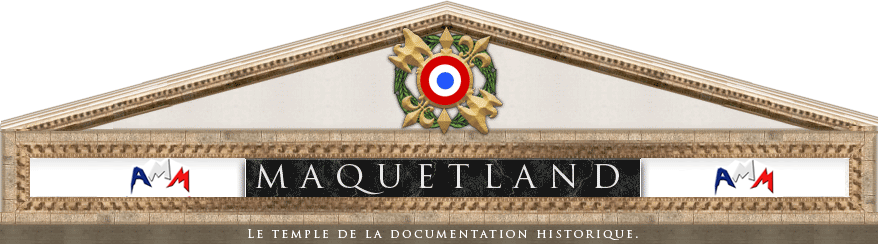
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour les Pavillons de Guerre des ports Francais c'etaient des drapeaux distinctifs utilisés par la marine royale pour identifier les navires de guerre selon leur port d’attache. Ils variaient avant l’uniformisation progressive de la flotte sous l’Ancien Régime.
Brest Tiré de ce site Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Brest n’était pas très reluisante. Premier signe peu avenant, Brest fut la proie de la peste depuis la Toussaint 1639 jusqu’en juillet 1640 : le fléau aurait emporté 170 personnes de tous les âges, soit le dixième de la population de l’époque !
En 1682, la Municipalité ordonna aux habitants « de faire paver les cours et de balayer devant les maisons, deux fois la semaine, sous peine d’amende » et décida de « transporter les immondices hors la ville ».
Des rues boueuses et mal entretenues
Des crédits furent également débloqués pour construire des lavoirs, des latrines et faire réparer les fontaines du Troulan et du Rocher. Toutes ces mesures donnent une idée de la situation… Mais elles n’arrangèrent rien
Des rues boueuses et mal entretenues Des crédits furent également débloqués pour construire des lavoirs, des latrines et faire réparer les fontaines du Troulan et du Rocher. Toutes ces mesures donnent une idée de la situation… Mais elles n’arrangèrent rien ! En 1712, les rues étaient toujours aussi boueuses et mal entretenues, Brest était synonyme de ville sale. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le nettoyage des rues fut attribué à des négociants puis à l’hôpital, mais ça ne régla presque rien. La grande misère de Brest au XVIIIe siècle L’insalubrité des rues de Brest au XVIIIe siècle n’était que la partie émergée de la misère qui y régnait. L’année 1709 fut marquée par des émeutes de la faim et, entre 1712 et 1715, plus de 500 familles, ouvrières pour la plupart, auraient quitté la ville. Les travailleurs qui n’habitaient pas « à Brest-même se logeaient à Saint-Pierre-Quilbignon ou à Lambézellec dans presque des tanières qu’on a la dureté de leur louer fort cher et d’exiger le paiement d’avance ». Pour ne rien arranger, les retards de salaire étaient courants, de sorte que l’ouvrier brestois vivait « à crédit », renchérissant du même coup les prix des denrées de première nécessité. Cette situation ne doit pas étonner : tributaire de son arsenal militaire, Brest devait sa plus ou moins grande prospérité à la situation géopolitique, de sorte que paix était pour ainsi dire synonyme de disette. ui dit misère dit aussi généralement » immoralité « . En 1777, le marquis de Langeron écrivait qu’il se buvait « 12 000 barriques de vin et 4 000 barriques d’eau-de-vie par an ». Les jeux de hasard s’attiraient eux aussi l’hostilité des autorités, mais l’activité la moins recommandable à prospérer sous l’effet de la pauvreté restait la prostitution : rien qu’en 1781, 88 « filles de joie » furent emprisonnées. De surcroît, le pavage coûtait très cher et les entreprises sollicitées n’allaient pas jusqu’au bout du travail. En 1767, la Mairie lança un plan de pavage de toutes les rues de Brest, mais l’intendant de Bretagne, qui donnait le feu vert aux Municipalités pour leurs dépenses, ne répondit pas. il fallut attendre deux ans pour que la Ville soit enfin autorisée à appliquer son plan qui allait lui coûter entre 10 000 et 20 000 livres par an jusqu’à la Révolution Le chateau de brest Tiré de ce site u fil des siècles, l’architecture du château est adaptée pour répondre à l’évolution des techniques de siège et de l’armement, visant à se prémunir de deux types d’attaques : terrestre et maritime. En 17 siècles d’histoire, le château ne sera jamais pris par la force.
Le camp romain d'Osismis : le castellum au IVe siècle
On ne sait rien aujourd’hui de l’occupation du site à l’époque préhistorique. La première implantation certaine est celle de soldats romains, probablement à la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle. Le site choisi pour l’établissement d’un castellum est un éperon rocheux entouré par la rade et le fleuve Penfeld, sur trois côtés.
Une garnison d'un millier de personnes y était cantonnée pour surveiller la rade et l'entrée de la Penfeld. A la fin de l'empire, le castellum est un site capital par sa position charnière entre Europe du Nord et Europe du Sud.De ce castellum, seule la courtine qui barrait l’éperon est relativement bien connue. Épaisse de quatre mètres, en appareillage romain à alternance de briques et de petits moellons, elle était rythmée par dix tours circulaires, et comportait très vraisemblablement une porte centrale. Elle s’élève encore aujourd’hui sur quatre à huit mètres de haut. L’enceinte se prolongeait probablement sur les trois autres côtés.
Au Ve siècle, l’effritement du pouvoir romain a pu se traduire par l’abandon du castellum. On ne sait rien ensuite de l’histoire de Brest à l’époque des rois mérovingiens et carolingiens (Ve-Xe siècles).
Le château médiéval vers 1380
Au XIe siècle, le castellum est toujours une place forte. Il appartient alors au vicomte de Léon installé à Morlaix, qui, accablé de dettes, le cède en 1240 au duc de Bretagne Jean Ier le Roux.
En 1240, le duc de Bretagne achète « la ville, le château et le port » de Brest. L’acte de vente est la première véritable mention du château dans l’histoire.
Lors de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364), qui débute à la mort du duc Jean III (1286-1341), la Bretagne se déchire entre deux partis soutenus l’un par les Français, l’autre par les Anglais. Ces derniers obtiennent le contrôle de la forteresse de Brest en échange de leur appui. Ils l’occupent de 1342 à 1397, y installant une garnison.
Le château et le port permettent aux Anglais de contrôler la route maritime qu’empruntent leurs navires entre l’Angleterre et la Guyenne (actuelle Aquitaine). Si Brest ne joue pas un rôle comparable à celui de Calais, elle est néanmoins un élément important de la stratégie anglaise sur le continent.
La guerre de Succession gagnée, le duc Jean IV (1339-1399) souhaite reprendre son bien. Cependant, ses alliés anglais s’y maintiennent, car le château conserve son importance stratégique dans la guerre de Cent Ans.
Bertrand Du Guesclin (1320-1380), noble breton, en tente le siège en 1378, en vain. Bretons et Français s’unissent pour un nouveau siège entre 1386 et 1387, sans plus de succès. Finalement, le duc de Bretagne Jean IV est contraint de racheter son château que les Anglais lui restituent en 1397.
La ville, avec l'église paroissiale Notre-Dame de Pitié, est incluse dans le périmètre de l'enceinte romaine, sans doute élargie vers l'ouest et vers l'embouchure de la Penfeld. A l'angle nord, le donjon construit par les comtes de Léon est renforcé par les ducs de Bretagne.
Le château d'Anne de Bretagne : le château des ducs vers 1480
En 1505, le château dans lequel séjourne la reine Anne de Bretagne (1477-1514) n’a plus rien à voir avec la forteresse occupée par les Anglais. Tout au long du XVe siècle, les ducs de Bretagne ont en effet conduit d’importants travaux de modernisation.
Face au développement de l’artillerie, qui met à mal les hautes tours et courtines médiévales, les ducs doivent adapter la forteresse. La tour Madeleine est renforcée ; les tours Paradis sont édifiées et constituent l’entrée de la ville close, protégée par un ravelin équipé d’artillerie. Les tours d'origine romaines subsistent encore et rythment le rempart. Le véritable château de l'époque englobe les tours Nord, Duchesse Anne et Azénor. Ce donjon est agrandi et modernisé. Il devient un véritable logis seigneurial.
La ville se développe lentement dans l’enceinte du château, mais aussi à ses abords. Dans la seconde moitié du XVe siècle, 260 habitations sont recensées, soit entre 1 000 et 1 200 habitants. Le port, excentré par rapport aux principales voies de commerce, ne se développe guère.
Quelques années plus tard, le château accueille un autre hôte de marque : le roi François Ier (1494-1547), qui y réside en septembre 1518. Il s’intéresse de fort près au port et ordonne la construction de bâtiments, ateliers et magasins.
Les guerres de religion : le château vers 1590
La fin de l'Indépendance bretonne, entérinée en 1532, fait du château de Brest une forteresse française. Modernisée, elle connaît l'épreuve du feu lors des guerres de Religion (1562-1598).
Au cours de la Ligue catholique, le gouverneur de la place reste fidèle au parti du roi protestant Henri IV (1553-1610). Brest constitue alors, avec Rennes et Vitré, l’une des rares villes qui s’opposent aux ligueurs catholiques appuyés par les Espagnols.
La défense du château est considérablement renforcée au courant du XVIe siècle. Il s’agit de l’adapter à la fortification moderne ou bastionnée. Les principaux travaux concernent le bastion Sourdéac (1560-1597), qui englobe et protège le Donjon afin de le mettre à l’abri de l’artillerie. Le front sud-ouest face à l’embouchure de la Penfeld est développé. La tour Française et la tour de Brest, conçues pour l’usage de l’artillerie, remplacent les tours médiévales. La tour Madeleine est « chemisée », c’est-à-dire enveloppée d’une maçonnerie qui triple la largeur du mur, atteignant ainsi douze mètres.
Le ralliement à la cause d’Henri IV vaut à Brest la reconnaissance du roi. Par lettres patentes en 1593, il accorde aux Brestois le droit de bourgeoisie. Brest devient une ville ; d’autant qu’une vraie bourgade s’étend désormais à l’écart du château, autour de la chapelle Saint-Yves et de l’église des Sept-Saints, érigée en paroisse en 1549. L’extension des défenses du château s’est accompagnée de la destruction du faubourg originel. Entre-temps, la ville close s’est peu à peu vidée de sa population. Les habitations cèdent la place à des casernes afin de loger la garnison. À la fin du XVIe siècle, la ville de Brest est sortie du château.
La citadelle Vauban : le château en 1710
Lorsque Vauban (1633-1707) arrive à Brest en 1683, la ville a déjà bien changé. En 1631, le cardinal Richelieu (1585-1642) a choisi Brest pour y créer l’un des ports de guerre de la Marine royale. À partir de 1669, ce choix s’accompagne du développement de l’arsenal sous l’impulsion de Colbert (1619-1683).
Pour Vauban, le château est un élément essentiel de la défense du port du Ponant. Il doit assurer la sûreté de la ville et du port. Vauban modernise ainsi la forteresse médiévale afin qu’elle puisse faire face aux progrès considérables de l’artillerie.
Il fait détruire les dernières tours romaines encore présentes. Les courtines sont remparées au moyen de terre : leur épaisseur passe de quatre à dix-neuf mètres entre la tour Madeleine et les tours Paradis.
Les tours médiévales perdent leurs toitures qui sont remplacées par des plates-formes d’artillerie ; seules les tours Paradis conservent leur aspect d’origine. Le Donjon est couronné par une vaste plate-forme capable de recevoir vingt canons.
Du côté de la ville, Vauban édifie un important front bastionné précédé d’un chemin couvert et d’un glacis qui l’isole totalement de l’agglomération. Le château-citadelle doit pouvoir se défendre face à un ennemi devenu maître de l’enceinte urbaine, mais aussi contre un soulèvement de la population qui peut être rétive face au pouvoir royal.
Vauban porte enfin son attention sur la défense de la rade, « la plus belle pièce d’eau de l’univers », selon lui, et sur ses approches : les baies de Camaret et de Bertheaume. S’il n’est pas le premier à édifier des batteries pour la défense des approches du port du Brest, il l’est en revanche pour la conception d’un plan d’ensemble. Ce dernier s’articule autour de trois axes : protection des baies de Camaret et de Bertheaume, essentielles à l’activité des navires avec leurs havres de relâche ; défense du goulet d’accès à la rade au moyen de nombreuses batteries dont les plus puissantes croisent leurs feux ; interdiction des mouillages dans la rade aux navires qui auraient pu y entrer, au moyen de batteries de canons et de mortiers.
Le principe de défense de la rade établi par Vauban demeure quasi inchangé jusqu’à la première moitié du XIXe siècle.
Le château au XVIIIe siècle
Le XVIIIe siècle est pour Brest une période d’intenses changements : la ville se développe rapidement autour du port et de l’arsenal, et devient l’une des deux grandes bases navales françaises avec Toulon. La population est multipliée par deux ; de nombreux bâtiments sont construits. Immuable, le château continue de symboliser le pouvoir royal.
La vieille forteresse reste avant tout le siège du pouvoir militaire, chargé d’assurer la défense de Brest contre un ennemi extérieur ou une révolte locale.
Le château conserve sa fonction de prison militaire pour les marins anglais ou les espions étrangers. Il remplit également son rôle de prison civile.
Le château garde également une fonction symbolique importante au sein de la ville. Chaque nouveau maire vient y prêter allégeance au gouverneur, représentant du pouvoir royal, le 1er janvier suivant son élection, recevant les clés de la ville des mains du gouverneur.
Pour autant, le véritable pouvoir n’est plus au château. L’homme fort à Brest est désormais l’intendant de la Marine, installé dans l’arsenal. En liaison régulière avec Versailles, son rôle dépasse largement celui de la simple gestion du port et de l’arsenal. Il est amené à intervenir sur presque tous les sujets, car c’est la Marine qui fait la ville et qui la transforme.
Pour continuer l’œuvre de rationalisation de l’arsenal déjà largement engagée, la Marine a besoin d’encore plus d’espace autour de la Penfeld. Elle obtient, entre 1785 et 1788, la dévolution du château. L’édification d’une statue à la gloire de Louis XVI (1754-1793) et de nouveaux bâtiments sont proposés à la place du château, mais la Révolution interrompt ce projet et sauve la forteresse.
|
|
Droit d’auteur La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc) Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande. Principaux Collaborateurs:
Nb
de visiteurs:8935849 Nb
de visiteurs aujourd'hui:2122 Nb
de connectés:66
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
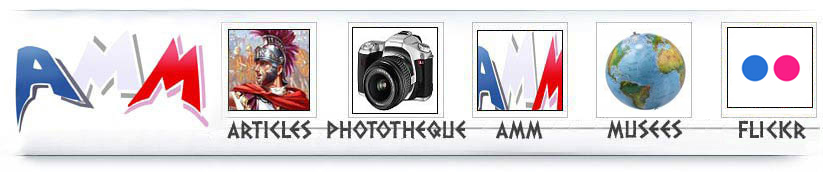




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
