Médiéval Italie Ravenne San Vitale Fresque VIIIe Siècle Fresque Missio Petrina Ravenne MN
English Translation
Historique Voir ICI
History Click HERE
Fresque représentant l'Apotre St Pierre le Martyr San Apolinare et l' Archevèque Martin
 |
Le panneau représente trois personnages debout.
Au centre, saint Pierre, plus grand que les autres, est vêtu d'une tunique et d'une toge. Il présente les traits typiques de l'iconographie canonique : une barbe blanche encadrant son visage et un trousseau de clés dans la main gauche. De la main droite, il offre quelque chose au personnage à ses côtés, identifié comme saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne. Le personnage de droite, reconnaissable à l'inscription, est Martin, archevêque de Ravenne, qui fut archevequer de 810 à 817. Il est représenté tenant un codex et la tête entourée d'une auréole carrée, un élément iconographique qui permet de l'identifier comme étant encore vivant à l'époque de la création du tableau. |
Au début du Moyen Âge, le pastophorium sud de l'abside de l'église San Vitale (VIe siècle) fut aménagé pour créer une chapelle destinée à abriter les sarcophages contenant les restes de trois évêques de Ravenne : Ecclesius (522-532), Ursicinus (533-536) et Victor (538-545).
Le pastophorium se trouve dans les basiliques paléochrétiennes de part et d'autre de l'abside (ou parfois rejetées le long des extrémités Nord et Sud des nefs latérales, soit à l'Est au niveau de l'abside, soit à l'Ouest à hauteur du narthex) : le diakonikon ou skeuophylakion, sorte de vestiaire et vaissellier du clergé d'une part, et la prothesis, l'endroit où sont conservées les espèces pour l'eucharistie
 |
Les travaux devaient être achevés dès les premières décennies du IXe siècle, puisque le protohistorien de Ravenne Andrea Agnello décrit la chapelle, dédiée à saint Nazaire à son époque, comme abritant déjà les trois tombes privilégiées. Par la suite, d'autres interventions de l'époque moderne modifièrent considérablement l'édifice, auquel seule une restauration dirigée en 1903 par Corrado Ricci permit de restituer son aspect d'avant le XVIe siècle (Ricci 1904).
 |
À l'origine, l'édifice, contemporain de la construction de la basilique, ne communiquait pas avec le lieu de culte et était accessible par un court passage parallèle au côté de l'abside, ainsi que par une porte extérieure
Au Haut Moyen Âge, les deux entrées existantes furent partiellement murées pour créer des niches, et une nouvelle entrée (celle toujours en usage) fut créée en abattant le mur reliant la chapelle à l'église.
Les niches latérales, créées en comblant les anciennes entrées, étaient destinées à contenir les sarcophages d'Ursicinus et de Victor (celui d'Ecclesius fut placé au centre de la pièce), et celle de droite était décorée d'une fresque dont de faibles traces ont été retrouvées lors de la restauration menée par Ricci (Novara 2016).
Le panneau représente trois personnages debout. Au centre, saint Pierre, plus grand que les autres, est vêtu d'une tunique et d'une toge. Il présente les traits typiques de l'iconographie canonique : une barbe blanche encadrant son visage et un trousseau de clés dans la main gauche. De la main droite, il offre quelque chose au personnage à ses côtés, identifié comme saint Apollinaire, premier évêque de Ravenne. Le personnage de droite, reconnaissable à l'inscription, est Martin, archevêque de Ravenne, qui fut archevequer de 810 à 817. Il est représenté tenant un codex et la tête entourée d'une auréole carrée, un élément iconographique qui permet de l'identifier comme étant encore vivant à l'époque de la création du tableau.
Les personnages, représentés de face, se détachent sur un fond rouge et sont disposés hiérarchiquement. Pierre, axe central de l'image, se distingue par sa force physique, avec un cou robuste bien proportionné à son visage et à ses épaules. Seuls deux visages sont lisibles, mais on distingue sur chacun d'eux des traits marqués, particulièrement accentués dans l'expression vigoureuse de Pierre. Les nez sont particulièrement prononcés, les bouches pleines, la barbe et les cheveux sont dessinés par de fines lignes parallèles. Les drapés des robes sont définis par des lignes audacieuses qui créent de larges plis parallèles.
L'image représente un thème typiquement local, à savoir la Missio petrina,ce qui veut dire avoir la mission d'évangéliser Ravenne que, selon la tradition connue grâce au texte hagiographique communément appelé Passio Sancti Apollinaris, l'apôtre Pierre confia au premier évêque Apollinaire.
Ce récit légendaire, probablement né au VIe siècle, prétend qu'Apollinaire d'Antioche fut envoyé à Ravenne par le « prince des apôtres » et qu'il y fut martyrisé par les autorités locales, non encore converties au christianisme. Ce tableau est le plus ancien exemple connu de l'imagerie de la Missio, qui connut son apogée dans les mosaïques de l'abside de la cathédrale de Ravenne en 1112.
La représentation non seulement glorifiait les origines de l'Église locale, mais accordait également une importance particulière au rôle de l'archevêque de la ville romagnole, héritier et continuateur de l'œuvre d'Apollinaire. Martin compte d'ailleurs parmi les prélats qui, après la chute de l'Exarchat, s'opposèrent à la politique papale.
Il est fort probable que le tableau ait été réalisé à l'issue de la restauration de la chapelle et qu'il ait été commandé par Martin, qui, en déplaçant les corps des trois grands évêques et en choisissant le thème représenté, souhaitait réaffirmer l'importance du rôle joué par l'Église de Ravenne dans la chrétienté occidentale.
Santi Muratori, premier à s'être penché sur l'interprétation du tableau en 1916 pensait que l'image avait également été commandée par Martin, qui aurait organisé son inhumation à l'intérieur de la chapelle, dans le sarcophage en pierre brute situé à côté de la niche ornée de fresques.
D après les spécialistes, le tableau peut être considéré comme une œuvre d'art réalisée par des artisans locaux, influencés par l'influence culturelle du monde byzantin, à travers les modèles établis à Ravenne aux Ve et VIe siècles, comme en témoignent surtout les figures humaines, encore dotées de traits corporels. L'œuvre témoigne également des nouvelles expériences carolingiennes qui se développaient alors en Italie du Nord et au-delà des Alpes.
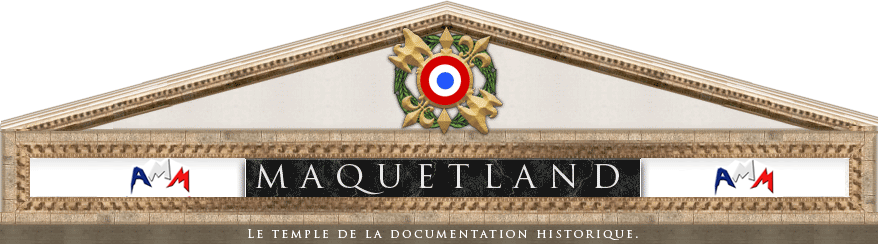
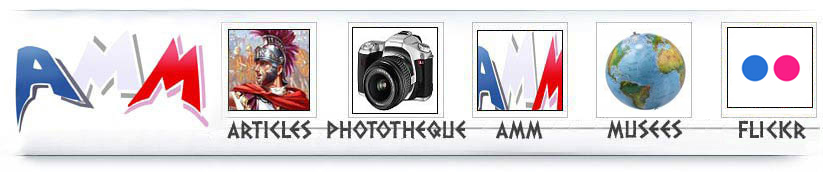




.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)