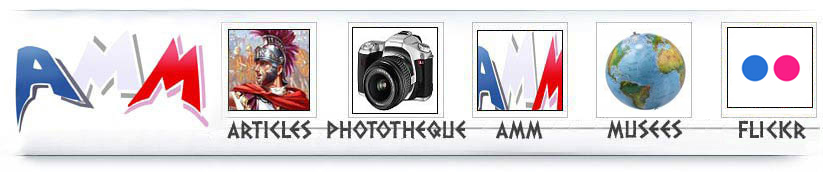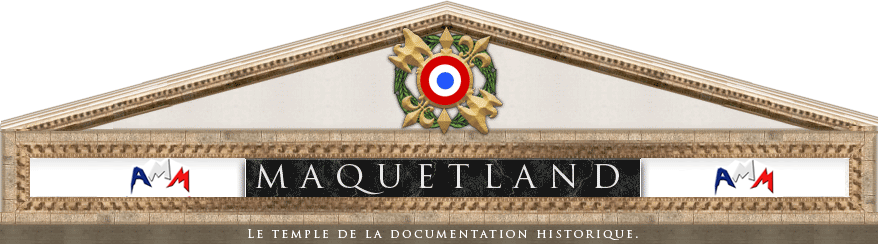
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Voir Aussi See Also Les lecteurs assidus de mon blog qui au fil du temps apprécient nos « articles-témoignages » inédits sur le Service de santé dans le nord-est, en 1914, (Sedan, Montmédy, Lille, Lens, etc.) sont régulièrement « en contact » avec le service de santé allemand (ex. le dernier en date : « Bapaume 1914 » et les feldlazarette…). Aujourd’hui il est temps de partager, avec le lecteur, quelques aspects de son organisation et de son fonctionnement. Il n’est pas question dans ce blog d’en faire de longs développements mais de mettre à la disposition des lecteurs un résumé des différentes structures sanitaires allemandes qu’ils sont susceptibles de rencontrer. Il reste, bien entendu, que les aspects « Traitement » et « Hospitalisation » des blessés seront plus longuement décrits, d’autant que bientôt… les lecteurs de la collection des Hôpitaux militaires dans la Guerre 1914-1918 (éditions Ysec, 2014) auront l’occasion, dans le tome 5, à paraître, de côtoyer ces ensembles hospitaliers allemands en zone occupée, implantés dans les anciennes structures hospitalières françaises (1914-1915) dont nous traiteront.
J’ai largement emprunté à l’ouvrage fondateur de Laparra et Hesse leur description du Service de santé militaire allemand dans la Guerre mondiale. J’ai complété cette synthèse par un article extrait des Archives de médecine et de pharmacie militaires (tome LXXX, 1er semestre 1924, p. 525-538) et par des documents provenant des fonds du service historique de la défense de Vincennes et du Musée du service de santé des armées, au Val-de-Grâce à Paris (cf. sources, in fine). Ce cadre ainsi posé sera prochainement illustré par de nouveaux témoignages de médecins français prisonniers (à l'HoE de Saint-Gilles, Cambrai, Rethel, Jarny, etc.) qui ont décrit par le détail, à l’intention des services de renseignements français (2e bureau, section allemande), l’organisation et le fonctionnement du service de santé allemand ; rapports, que les « sanitaires » ont nourri de commentaires personnels et de comparatifs avec le service de santé militaire français qui sont inédits.
Notes sur l’organisation et le fonctionnement du service de santé de l’armée allemande (1914-1918)
Zone de l’avant (Operation Gebiet)
Bataillon/Régiment : Ramassage – Mise à l’abri du soldat, au niveau de chaque compagnie d’infanterie, dans un « abri du service de santé » (Sanitätsunterstand). Premiers soins : Chaque bataillon a les moyens d’organiser un « poste de secours » (Truppenverbandplatz). Les postes de secours (P.S.) de bataillons peuvent être regroupés au niveau régimentaire en un P.S. unique de 20 à 30 blessés : premiers soins, premier triage avec établissement d’une « fiche de blessure » (Wundzettel) ou de maladie (Krankenzettel), injections antitétaniques, pansements, etc.
Les blessés légers sont dirigés sur l’infirmerie régimentaire ou de cantonnement (Regiments ou ortskrankenstube), puis de là vers un « point de rassemblement de blessés légers » (Leichtverwundetensammelplatz). Les autres blessés sont dirigés vers le « poste de répartition de malades et blessés » (Krankenverteilungsstelle) et de là envoyés au « poste de secours principal » (Hauptverbandplatz) par les moyens de la « compagnie sanitaire » (Sanitätskompanie). Cette compagnie correspond au Groupe de brancardiers divisionnaires (G.B.D.) français renforcé d’une ambulance.
Division : Triage et Traitement - La sanitätskompanie, à raison de 1 à 2 par division, est en charge du ramassage, du triage, du premier traitement des extrêmes urgences (E.U.) ; elle assure les évacuations et le transport sanitaires. Elle est chargée de l’organisation : d’un « point de stationnement de voitures sanitaires » (Wagenhalteplatz) ; d’un « centre de regroupement de blessés légers » (Leichtverwundetensammelplatz) ; d’un « poste de secours principal » (Hauptverbandplatz) où sont traités les extrêmes urgences.
Les blessés graves évacués sont arrêtés à « l’hôpital de campagne » (Feldlazarett), situé à 15 ou 20 kilomètres du front, installé dans une école, un château ou une église, etc.). L’on y traite les 1ères urgences (U.1). Les blessés ne peuvent y être conservés au-delà de 4 à 5 semaines. Les Feldlazarette assurent également les soins de proximité (lunetterie, soins et prothèses dentaires, etc.). En 1914, l’on trouve 12 feldlaz. par corps d’armée (C.A.) ; en 1916, deux feldlaz. par division et deux supplémentaires au niveau C.A. qui peuvent être spécialisés (gazés, vénériens, contagieux, etc.). Chaque feldlaz. qui comprend – théoriquement – 200 lits est aux ordres d’un médecin-chef qui dispose de 60 militaires : 6 médecins, 1 pharmacien, 9 à 12 sous-officiers infirmiers, 14 brancardiers, des aides-soignants et des soldats du Train pour s’occuper du parc hippomobile de la formation.
Zone des Etapes (Etapengebiet)
« L’hôpital de guerre » (Kriegslazarett) est installé dans les localités importantes situées en arrière de la zone des opérations, dans celle des étapes. Les Kriegslaz. sont des formations hospitalières d’infrastructure sédentarisées, de 300 à 400 lits, parfois de plusieurs milliers. Ils reçoivent les blessés directement des « postes de répartition de malades et blessés » (Krankenverteilungsstelle) pour des traitements immédiats (évacués primaires, non opérés, U.2 ou U.3) ou spécialisés (évacués secondaires, déjà opérés, E.U. ou U.1). Les kriegslaz. disposent de moyens chirurgicaux importants et de leur environnement technique (laboratoires, radiologie, etc). Les kriegslaz. sont groupés par 3 ou 4 dans un « détachement d’hôpitaux de guerre » (kriegslazaretteabteilung). Chaque C.A. dispose d’un kriegslazaretteabteilung dirigé par un « directeur des hôpitaux de guerre » (Kriegs.-Direcktor). Ces établissements et sa direction forment un kriegslaz.-dir. u Abt., en quelque sorte un centre hospitalier qui peut intégrer en plus des kriegslaz. des : « centre pour blessés légers » (Leitchkrankenabteilung), ainsi que des hôpitaux spécialisés : pour contagieux (seuchenlazarett,), typhiques (typhuslazarett), pour gazés, pour les prisonniers de guerre (kriegsgefangenenlazarett) ainsi que des moyens mobiles de buanderie (lazarettkriegswaschreien). Effectif : le kriegslazarettabteilung possède un effectif global fixe, composé de personnels militaires ou assimilés, dont 19 médecins, 1 dentiste et 3 pharmaciens, des infirmières (armee-schwester) renforcé d’une section d’hôpital (infirmière, cuisinières, etc.) provenant du « service volontaire de soins aux malades » (freiwillige krankenpflege) qui regroupe toutes les associations relevant de la Croix-Rouge allemande. « A la fin de la guerre, le personnel sanitaire des groupes d’hôpital de guerre (kriegslazaretteabteilung) comprenait environ : 40 officiers sanitaires, 3 pharmaciens, 6 dentistes, 9 inspecteurs d’hôpital, 50 sous-officiers, 150 infirmiers et de 50 à 150 infirmières. Il y avait des groupes d’hôpitaux atteignant 6 000 lits » (Magnoux). L’hôpital de guerre, formation sédentaire, nécessite pour son déplacement la mise en place d’un ou deux trains.
« L’hôpital d’étapes » (Etappenlazarett) établi au chef-lieu des étapes d’une armée est en charge des soins des malades et blessés des unités et services qui y sont stationnés ou les traversent. Effectif : 1 ou 2 médecins (éventuellement un civil) secondé par des volontaires du Freiwillige krankenpflege et du personnel civil y compris médical. A proximité se trouve un « centre de regroupement de malades et blessés légers » (Leichtkrankensammelstation). Exemples Etappenlaz. : Montmédy, Pierrepont, Tournai, etc.
Des établissements pour convalescents reçoivent les blessés et malades à leur sortie des hôpitaux de traitement , ce sont : des « sections de convalescents » (Genesungzug), des « détachements de convalescents » (Genesungsabt ou Genesenden-Abt.).
Zone de l’Intérieur (Heimatsgebiet) – Alsace-Lorraine, Belgique, Allemagne
Cette zone accueille les blessés et malades évacués du front : évacuations primaires, 3e urgence (U.3) ou les évacuations secondaires provenant des kriegslaz. qui nécessitent une suite de traitement. Ce sont :
Les « hôpitaux de réserve » (Reservelazarette) qui sont d’anciens hôpitaux de garnison (Garnisonlazarette) et des hôpitaux auxiliaires (Vereinlazarette) constitués sur le modèle des kriegslaz. Exemples Res.laz. : Dieuze, Marcoing, Liesse, Grandpré, etc.
Les « hôpitaux d’association ou hôpitaux auxiliaires » (Vereinlazarette) qui fonctionnent avec des personnels civils sous le contrôle du service de santé militaire allemand (Nombreux exemples à Metz, Mulhouse, Strasbourg, etc.).
Les « hôpitaux de forteresse » (Festungslazarette) sont installés dans les régions fortifiées. Ce sont des hôpitaux militaires d’infrastructure (cas de Metz ou de Namur, par exemple) et/ou des hôpitaux auxiliaires (Vereinlazarette), organisés sur le même modèle que les kriegslaz.
Notes d’organisation et de fonctionnement sur le service de santé régimentaire de l'armée allemande (1914-1918) :
« Le médecin-chef du régiment (Oberstabsarzt, médecin-major 1ère classe) se tient avec un médecin aide-major (Oberartz), un médecin auxiliaire (unterartz), un sous-officier, 4 infirmiers et 16 brancardiers au poste de secours principal du régiment (P. S. R.) qui, en période de stabilisation, sert d’infirmerie de cantonnement.
« Dans chaque secteur de régiment, écrit le général von Below, environ à 2 ou 3 kilomètres en arrière de la 1ère ligne, il faut organiser divers abris (de préférence dans des caves réunissant les conditions nécessaires) pour servir de poste de secours régimentaire et susceptible du recevoir environ 100 blesses couchés. Il faut que chaque local ait 2 issues et permette le passage facile des brancards. »
Chaque bataillon possède un médecin-major ou un aide-major, un médecin auxiliaire, un sous-officier infirmier, 4 infirmiers et 16 brancardiers, qui se tiennent dans le P. S. B. : seuls les malades très légers y sont gardés quelques jours. Le général von Below demande «qu'il soit construit, à proximité de la réserve du bataillon, quelques abris pouvant recevoir de 25 à 40 hommes et une grande réserve da matériel sanitaire ».
Le « bataillon artz » marche à cheval à côté du chef du bataillon et de l'officier adjoint « adjudant ». Ce dernier fixe l’emplacement du P, S. B. « Trüppenverbandplatz » et du point de rassemblement des blessés légers « Leichtverwundetensammelplatz ».
Au moment d'engager le combat, le chef de bataillon donne directement ou par écrit ses ordres au médecin du bataillon.
La voiture médicale (sanitäts wagen), attelée de 2 chevaux, marche avec le train de combat du bataillon.
Enfin, chaque compagnie, quand elle tient un secteur possède un petit poste de secours (P.S. C.) refuge-abri souterrain, à l’épreuve, voisin des premières lignes, dans lequel se trouvent un sous-officier infirmier et 4 brancardiers. En cas de nécessité, il peut demander 4 brancardiers supplémentaires occasionnels, qui sont munis d'un simple brassard rouge uni.
« Dans les périodes où la lutte est très active, ajoute von Below, il faut qu'il y ait dans chaque secteur de compagnie un abri sanitaire, tout à fait à l'épreuve, capable de recevoir 14 blessés couchés, à proximité de la 2e ligne et dans chaque secteur de compagnie. En outre, il faut avoir des locaux pour abriter le personnel sanitaire et le matériel sanitaire pour les premiers soins à donner aux blessés ; les brancards de tranchée, les couvertures, l'eau minérale, le matériel de désinfection, le matériel de réserve contre les gaz, des vivres de réserve, etc.».
En résumé, le Service Médical régimentaire est à peu près semblable au nôtre avec ses trois échelons (P. S. C. — P.S.B. — P. S. R.), généralement assez bien installés, dans des abris à l'épreuve. Ces P.S. souterrains, comme le réclame le général von Below, doivent être longs, solides, secs, avec couchettes latérales superposées, pour abriter momentanément de nombreux blessés, ainsi que le personnel, le matériel sanitaire, les substances désinfectantes et la réserve de masques et d'appareils anti-asphyxiants.
Service des évacuations. — Les blessés des compagnies en ligne sont acheminés des P. S. C. et des P. S. B. sur le P. S. R. (truppenverbandplatz) par les brancardiers des bataillons. C'est là que les brancardiers de la Sanitäts Kie (G. B. D.) viennent chercher les blessés pour les transporter sur des brancards au « Wagenhalteplatz » (arrêt des voitures) appelé aussi « zwischenhauptverbandplatz » (poste intermédiaire de secours). Les blessés sont ensuite transportés au « hauptverbandplatz » (poste principal de secours) de la division en auto ou en voiture (Krankenwagen) et enfin à un « Feldlazaret ». » - Docteur Bonnette, article publié dans Le Progrès Médical, du 12 janvier 1918. In Variétés - Service de Santé allemand en campagne, p. 16)
Le personnel infirmier et brancardier allemand : équipements et dotations (1914-1918)
Poste de secours de compagnie. — Ce P. S. est installé dans un abri blindé, voisin des tranchées de résistance. Généralement on y trouve une petite caisse, renfermant quelques paquets de pansement, de la gaze, teinture d'iode, etc., permettant de faire un premier pansement. Le sous-officier infirmier a sous ses ordres 4 brancardiers provenant : 2 du premier peloton el deux du second peloton de la compagnie. En cas de nécessité, ils peuvent être renforcés par 4 brancardiers auxiliaires (brassard rouge uni), qui sont demandés au capitaine. Ces brancardiers sont capables de faire un premier pansement au moyen des paquets individuels. Les blessés sont ensuite transportés par deux brancardiers jusqu'au « Revier ». — Ce poste de secours de bataillon comprend :
Une salle de visite (Untersüchnugsranm); une salle de malades (Krankenzimmer); une salle d’isolement (Senchenranm).
Brancards — Les brancardiers se servent en principe du brancard réglementaire bien connu. Toutefois, dans les tranchées souvent démolies et les boyaux étroits, où la circulation est difficile, ils se servent de préférence de la «Nottragbahre» (brancard de fortune), consistant en une toile de tente soutenue par un bâton. Les brancardiers ont toujours un petit approvisionnement de perches au P. S. de compagnie. Mais, dès la sortie du boyau, le blessé est placé sur un brancard ordinaire ou, avec une seconde perche, cette toile de tente est transformée en un brancard horizontal. La «Stuhlbahre», brancard en forme de chaise, portée par un ou deux brancardiers, est moins utilisée, mais est assez pratique lorsqu'on la porte à deux. La Stuhlbahre est une chaise faite avec des tubes d'acier et de la toile à voile. Au bord du siège, se trouve une palette mobile pour soutenir le membre fracturé. Le transport d’un blessé en Stuhlbahre par un brancardier est très pénible; à deux, il est notablement plus facile. Ce moyen de transport est surtout préconisé pour les blessés thoraciques. Les brancardiers signalent encore la «Schützengrabentragbahre» (brancard de tranchée) ou brancard à cadre métallique, avec sous-cuisses et courroies sous-auxiliaires., et deux toiles enveloppantes, qui enserrent le blessé et permettent de le transporter dans toutes les positions : ce brancard est similaire à ceux de Mooïg ou de Matignon.
Insignes de neutralité des brancardiers. — Le brancardier se distingue par un brassard blanc à croix rouge qu'il porte au bras gauche (2 cachets humides du ministère). Il est muni, en outre, d'une attestation (ausweis), délivrée par le chef de service, l’autorisant à porter ce brassard.
Cartouchières et revolver. — Chaque brancardier est muni de deux cartouchières d’environ 10 sur 20 centimètres, qu'il porte des deux Côtés de la plaque du ceinturon. Dans ces cartouchières, il place : 12 paquets de pansements petits, 3 paquets de pansements grands, 2 morceaux de tissu triangulaire (en serge grise noire, comme écharpes, 2 morceaux de tissu carré, 1 flacon de teinture d’iode, 1 paire de ciseaux, 1 pince, 1 bande hémostatique en tissu élastique portant à une des extrémités des boutons à pression, 2 paquets de gaze. Les brancardiers sont armés d'un revolver automatique et sont porteurs d'un bidon contenant 1 litre de café.
Renseignements divers :
Les feuillées, voisines des tranchées, ont des fosses profondes de 2 mètres environ, de 3 mètres de long et au moins d'un mètre de large. Ces feuillées ont un plancher avec trois ou quatre longs trous « à la Turque », pas de séparations entre ces trous. Les cabinets avec sièges sont rarement utilisés. Les feuillées sont recouvertes d’un abri. Le chlorure de chaux est surtout employé comme désinfectant.
Urinoirs improvisés. — Dans les tranchées, il existe de nombreux urinoirs improvisés avec deux planches en V, formant une auge légèrement inclinée vers un puisard de 1 mètre de profondeur, garni de grosses pierres et destiné à recevoir les urines. A défaut de puisard, il est utilisé des récipients métalliques goudronnés à l’intérieur. Au-dessus des auges on place un plan vertical en planches recouvert de papier goudronné, ou mieux de zinc.
Robusticité [sic] des brancardiers. — Pour être brancardier dans l'armée active, il fallait être très robuste, et avoir un minimum de 1 m 68 de taille.
Transport des blessés. — Dans les boyaux démolis ou tortueux, la préférence unanime des brancardiers est le transport du blessé dans une toile de tente. Malgré toute sa force, un brancardier ne peut transporter seul qu’un blessé très léger. La fatigue est encore accrue, quand il est obligé de se pencher fortement en avant, comme dans le transport en stuhlbahre.
Pansements en papier. — Sont très peu utilisés sur le front, car ils se délitent trop facilement sous la pluie ou le sang. Ils sont surtout employés dans les hôpitaux de l’intérieur.
Casques en acier. — Tous les brancardiers allemands sont dotés de ce casque depuis environ un an, la troupe depuis près de deux ans. Les casques en cuir ont été reversés. Seuls, les officiers à l'arrière sont autorisés à se servir de leurs casques en cuir bouilli. Le casque en acier allemand pèse 980 grammes, mais les trois coussinets, qui sont à l’intérieur, en répartissent bien le poids et le font vite accepter. Les médecins militaires allemands ont aussi constaté que les plaies crâniennes ont diminué de fréquence et de gravité. Sur les côtés du casque, se trouvent deux saillies métalliques perforées d'un canal central pour la ventilation et servent de pivot à une visière ajourée, qui peut se rabattre sur les yeux au moment de l'assaut; mais cette visière a été rarement employée.
Insignes de neutralité. — Les infirmiers et les brancardiers sont dotés d'un large brassard avec croix rouge très visible, portant deux timbres humides. Chacun d'eux possède une autorisation signée de leur chef de service pour le port de cet insigne : cette autorisation est imprimée sur un papier entoilé :
Ausweis (1)
Name : Dienstgrad : Truppenteil :, Ist gemäh Artikel 20 des Genfer Abkommens vom 6. Juli 1906 zum Tragen des Neutralitätszeichens, einer auf dem linken Arme befestigten von der Militärbehörde gestempelten Binde mit dem Roten Kreuze auf weihem Grunde, berechtigt.
Truppenteil : Kommandeur : Unterschrift, Zur Gegenprobe : (Unterschrift des Inhabers).
(1) Permis, nom, grade, unité. Selon l'article 20 de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, l’insigne de la neutralité consistant en un brassard avec croix rouge sur fond blanc fixé sur le bras gauche : ce brassard porte un timbre de l’autorisation militaire,
Unité, chef de l'unité (signature). Signature du porteur. Les infirmiers, qui ont subi avec succès l'examen du caducée portent cet insigne sur le bras droit. (Grand ovale au centre duquel se trouve un serpent en drap jaune, enroulé sur un bâton d’Epidaure.
Plaque d'identité (Enkennungsmarke). — Les plaques d'identité des infirmiers et des brancardiers sont du nouveau modèle et portent les indications suivantes : le nom de l’homme, son adresse (ville, rue, n°), la date de naissance, le corps auquel il appartient, l’unité et le n° matricule. En outre, ces plaques, qui sont deux fois plus volumineuses que les anciennes, présentent à leur centre trois dépressions longitudinales, de telle sorte que les deux moitiés de la plaque portant deux fois les mêmes indications, tout en adhérant suffisamment, puissent être séparées facilement. Quand un soldat allemand est tué, on enlève seulement la partie inférieure de la plaque et la partie supérieure est laissée fixée au cou, de manière à permettre d'identifier ultérieurement le cadavre.
Carnet de prêt (soldbuch). — Comme tous les soldats allemands, chaque infirmier ou brancardier est détenteur d’un carnet de prêt qui sert de pièce d'identité militaire et présente plusieurs indications médico-militaires. A la page 4 figure la date des diverses vaccinations; ex. : Typhoïde : 26.2.15, 6.3.15, 12.3.15 ; Choléra : 12.3.15, 17-4-15 ; A la page 10 et 15 sont notées les diverses hospitalisations dans les feld et kriegs lazarette.
Vaccinations antityphoïdique et anticholèrique. — En général, les allemands font 3 injections antityphoïdiques et 2 injections anticholériques, à huit jours d’intervalle. Elles se font en avant et au-dessous du mamelon gauche, au lieu d'être faites dans la région rétroscapulaire, comme en France. La peau est désinfectée à la teinture d'iode, les aiguilles de Pravaz sont bouillies et les flacons, bouchés à l’émeri, renfermant le sérum, sont versés dans une cupule bien aseptique. Tous les soldats, presque sans exception (même ceux des plus vieilles classes), sont vaccinés. Unité, chef de l'unité (signature). Signature du porteur. Quelques soldats présentent des réactions fébriles assez marquées, les vomissements sont exceptionnels et les décès inconnus. Les vaccinations anticholériques sont particulièrement bien supportées.
Pansement individuel. — Est un petit paquet de 7 centimètres de long, 5, de large et 3 de haut. Il est recouvert d'une toile grisâtre, forte, qui porte, comme indication, l'année de la fabrication, puis une enveloppe en papier jaunâtre sur laquelle est indiquée la façon d'ouvrir le pansement sans le souiller. La bande porte à une de ses extrémités une compresse de gaze rosée (imbibée de sublimé). Le globe de la bande doit être saisi par la main droite et la main gauche doit saisir l'extrémité qui porte l’indication « hier ». Et en faisant une légère traction, la compresse s'ouvre et s'applique sur la plaie sans qu'on la touche. Les pansements individuels sont utilisés pour les petites blessures. Chaque soldat porte sur lui deux de ces pansements, qui sont placés dans une pochette sous le pan gauche antérieur de la vareuse. Pour les blessures graves, étendues, il existe des pansements plus grands, tout prêts, qui sont entreposés avec le matériel sanitaire (gouttières, etc.,) dans les paniers ou armoires des P.S.
Pansements en papier. — Ce papier ressemble à du crèpe Velpeau. Les pansements ont été fabriqués pour économiser la gaze et le coton. Ils sont surtout employés quand ils doivent être promptement remplacés. En cas d'hémorragie un peu abondante, ces pansements en papier se désagrègent très vite. Les médecins régimentaires recommandent aux infirmiers d'appliquer les pansements individuels à sec, car la compresse rosée qui est imprégnée de sublimé, peut produire au contact de la teinture d'iode, une dermite médicamenteuse désagréable.
Leucoplaste. — Les infirmiers allemands font un très grand usage du leucoplaste (rouleau de zink-kantschuk-pflaster) pour fixer et maintenir les pansements au lieu et place des bandes.
Bandes de pansement au bismuth. - Les médecins allemands emploient beaucoup des bandes au bismuth (bandes du Dr Von Bardeleben) contre les brûlures. C'est un pansement commode, économique, calmant rapidement la douleur et ne nécessitant pas son renouvellement fréquent. En outre, il se conserve très bien en magasin. Ces bandes « Bardella » ont été également utilisées dans les cas de datres exsudantes, d'ulcères des jambes, engelures ulcérées, de congélation, d’écorchures et de pansement ombilical des nouveaux nés. Actuellement, ils l’emploient pour les plaies consécutives aux gaz vésicants. Il est recommandé de fixer ces bandes par une couche de coton hydrophile, qui doit seule être changée lorsqu'elle commence à être imbibée. Ces bandes doivent être laissées plusieurs jours au contact des plaies. Pour les renouveler il y a lieu d'imbiber le coton et la bande avec de l'eau chaude stérile, puis refaire le pansement au bismuth. Avant la guerre, en Allemagne, ces bandes bismuthées étaient très employées dans les usines, où les ouvriers étaient exposés aux éclaboussures d'acide sulfurique. En cas d'accident, on commençait par laver ces brûlures à grande eau, puis avec une solution légère d'ammoniaque ou de soude pour neutraliser l'action de l'acide. Puis, après avoir épongé la plaie, on appliquait un morceau de bande Bardella, qui calmait la douleur et faisait promptement cicatriser la brûlure. » - P. Bonnette. Le Progrès médical, bulletin, 1918, Service de santé allemand. Service régimentaire. p. 286-288. |
|
Droit d’auteur La plupart des photographies publiées sur ce site sont la propriété exclusive de © Claude Balmefrezol Elles peuvent être reproduites pour une utilisation personnelle, mais l’autorisation préalable de leur auteur est nécessaire pour être exploitées dans un autre cadre (site web publications etc) Les sources des autres documents et illustrations sont mentionnées quand elles sont connues. Si une de ces pièces est protégée et que sa présence dans ces pages pose problème, elle sera retirée sur simple demande. Principaux Collaborateurs:
Nb
de visiteurs:8961584 Nb
de visiteurs aujourd'hui:3105 Nb
de connectés:44
| |||||||||||||||||||||||||||||